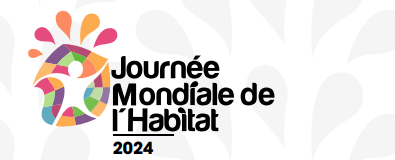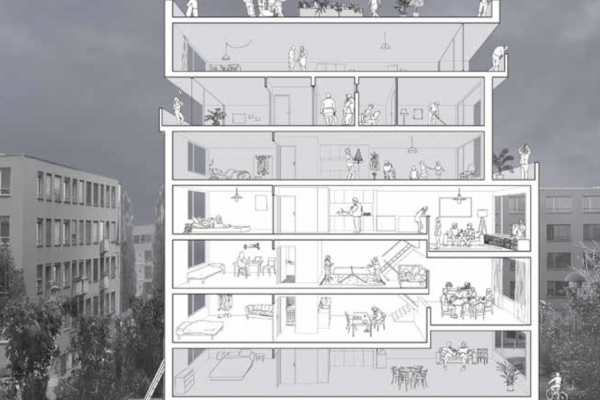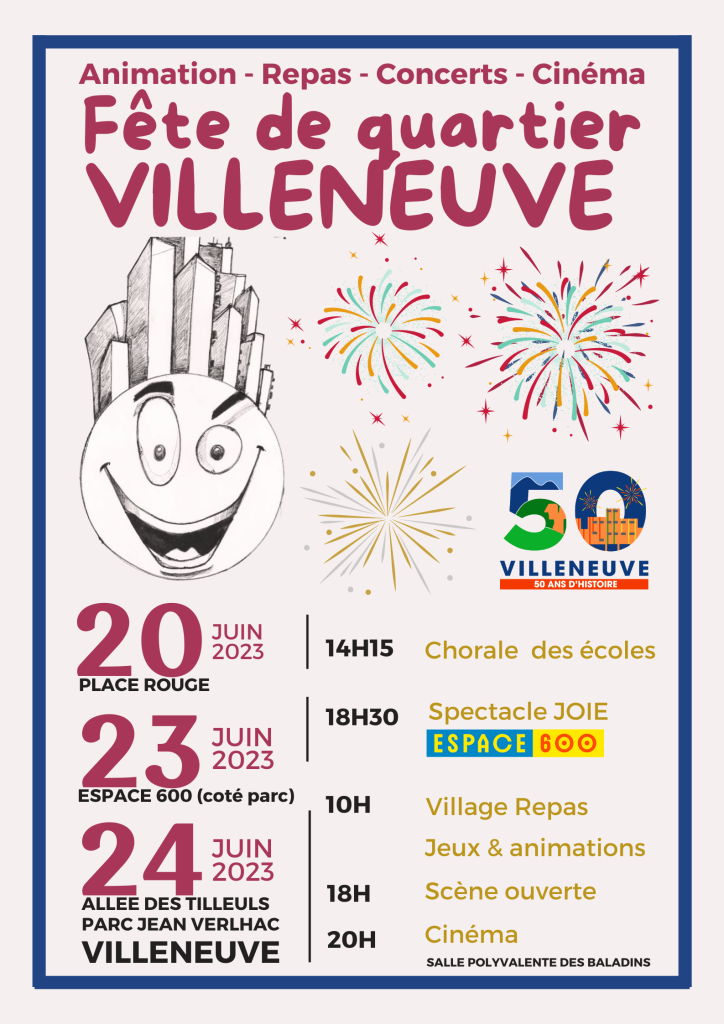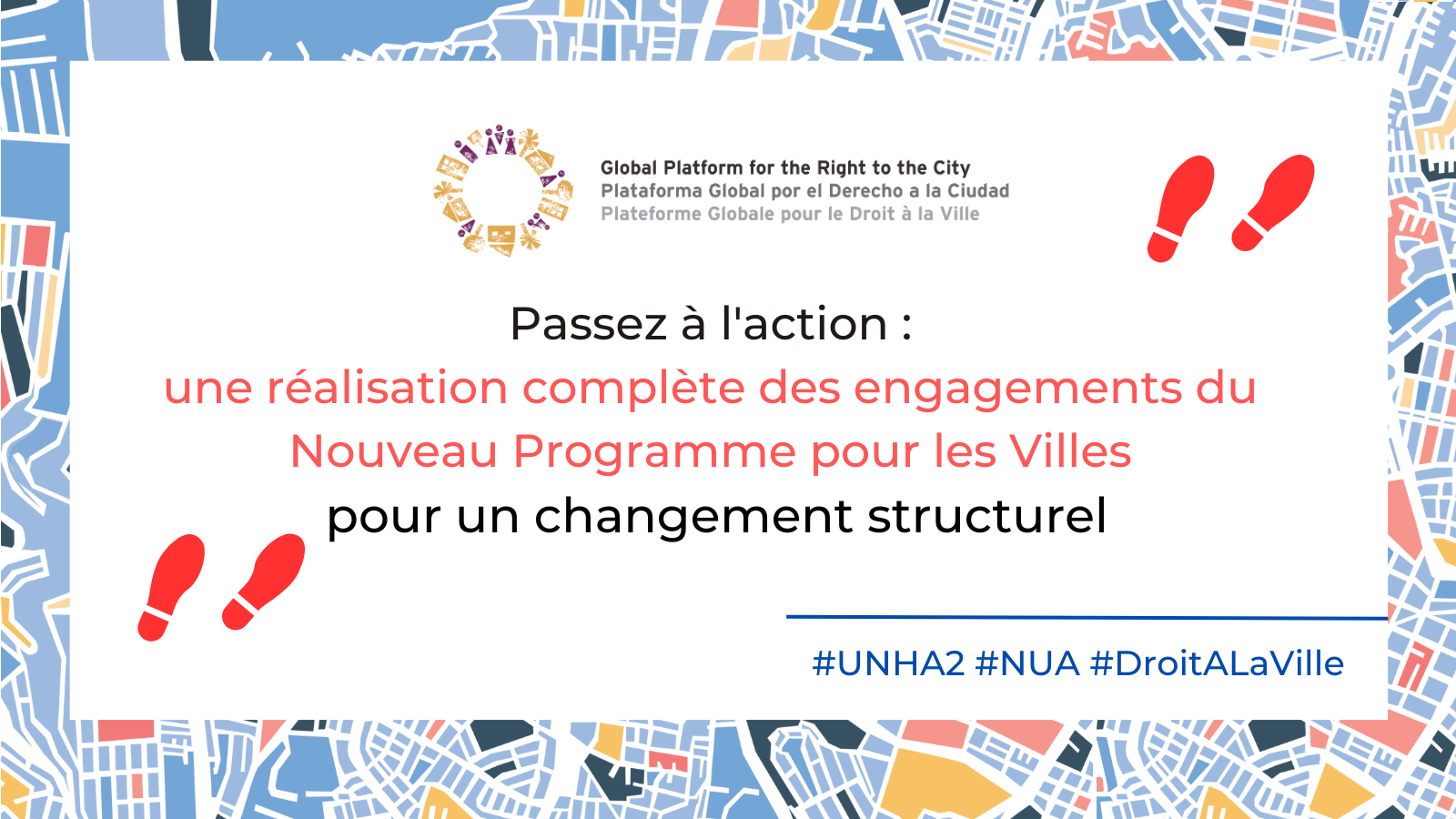Présentation
L’Assemblée des Communs (animée par Next Planning) participe à un projet tuteuré avec des étudiant-es de l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Un premier projet tuteuré a été proposé à ScPo Grenoble en septembre 2022 (voir annexe) sur la question des acteurs et de la gouvernance de ce Parlement. Les étudiants ont rendu leur travail en février 2023 et l’ont présenté en séance public et participative lors d’une soirée à Meylan.
A la suite de ce travail, en mai 2023, un projet de Parlement de la rivière Isère a été proposé aux acteurs institutionnels par un collectif de 4 associations dont FNE38 et l’Assemblée des Communs, en mettant en exergue l’inquiétude de l’opinion publique portant sur les usages de l’eau sur le territoire de la métropole de Grenoble, et aux alentours, sur l’état des nappes phréatiques affectées par des polluants éternels, sur les rejets industriels dans les cours d’eau, sans compter les perspectives de sécheresse à venir
En réponse à cette inquiétude, les 4 associations ont proposé aux acteurs de l’eau de soutenir le projet de Parlement de l’Isère qui prévoit :
– La constitution d’un observatoire de l’eau (adossé à un conseil scientifique) qui aura pour fonction de rassembler d’une manière neutre toutesles informations relatives à l’eau (cours d’eau et nappes) qui peuvent impacter nos territoires
– L’animation d’une mobilisation citoyenne autour des enjeux de l’eau
– L’animation de manifestations culturelles autour du même thème afin de révéler et amplifier les
attachements à la rivière et à l’eau
-Le plaidoyer, la communication autour des enjeux de l’eau
– Un groupe de réflexion et d’innovation.
Le projet tuteuré
Les 4 associations pensent, après cet envoi, réfléchir à l’évolution de ce projet de Parlement. Dans cette perspective, l’idée d’un Parlement ancré dans une « Biorégion » fait son chemin, la « Biorégion » étant considérée comme un territoire délimité par des caractéristiques écologiques relativement homogènes et autonomes. On y trouve une uniformité de conditions d’influence du
vivant, conditions qui à leur tour influencent l’occupation humaine et donc influencent l’idée d’un Parlement de la rivière Isère.
La commande
Après un premier projet tuteuré favorisant une entrée « gouvernance », ce nouveau projet tuteuré privilégiera une entrée « territoriale ». Il devra répondre à la question de l’intégration de ce Parlement de l’Isère à une Biorégion de référence :
-en réalisant une analyse documentée et critique sur le concept de Biorégion
-en étayant les diverses dimensions d’une telle intégration
-en proposant des éléments de définition du territoire de ce Parlement intégré à une Biorégion
-en proposant des éléments pour définir l’échelle la mieux adaptée pour ce Parlement de l’Isère.
Dans cette recherche, il conviendra de considérer l’expression « territoire » au sens large dans ce monde du vivant interdépendant.
Livrables
Le livrable consistera en un rapport contenant :
- Une synthèse organisée et critique de la recherche documentaire
- Les résultats des réflexions et des propositions
-sur les dimensions de l’intégration du Parlement à une Biorégion
-sur le territoire de ce parlement intégré
-sur l’échelle la mieux adaptée - Une production de cartes est attendue.
- Ce rapport sera présenté lors d’une restitution publique.
Les 4 associations se proposent d’accompagner régulièrement les étudiants et leur encadrement dans
le cadre de points d’étapes dont l’agenda est à convenir.
Bibliographie indicative et ressources
ALLAIRE Gilles, 2019. L ’ambivalence des communs. Développement durable et territoires, vol. 10, n°1.
(https://journals.openedition.org/developpementdurable/13442).
BUCHS Arnaud, BARON Catherine Baron, FROGER Géraldine et PENERANDA Adrien, 2019. Communs
(im)matériels : enjeux épistémologiques, institutionnels et politiques. Développement durable et territoires. vol.
10, n°1 (https://journals.openedition.org/developpementdurable/13701)
DARDOT Pierre LAVAL Christian, 2015. Communs : essais sur la révolution au XXIème siècle, La découverte.
DEFALVARD Hervé, 2023. La société du commun.Pour une écologie politique et culturelle des territoires. Les
éditions de l’atelier.
DE TOLEDO Camille, 2021. Le fleuve qui voulait écrire : les auditions du Parlement de Loire, Les liens qui libèrent.
GRABER Frédéric, LORCHER Fabien, 2020. Posséder la nature : environnement et propriété dans l’histoire, Editions
Amsterdam.
GUIHÉNEUF Pierre-Yves, VILLARROEL Alexandra, 2017. Concertation et environnement: Les acquis des
expériences locales, Comédie.
OSTROM Elinor, 2010. Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, De
Boeck.
PETIT Olivier, ROMAGNY Bruno, 2009. La reconnaissance de l’eau comme patrimoine commun : quels enjeux pour
l’analyse économique ? Mondes en développement, vol. 145, p. 29-54.
STARHAWK, 2019. Quel monde voulons-nous ?, Cambourakis.
STENGERS Isabelle, 2002. Sciences et pouvoirs : la démocratie face à la technoscience, La Découverte, 2002.
WEINSTEIN Olivier, 2015. Comment se construisent les communs. In CORIAT Benjamin (dir.), Le retour des
communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les liens qui libèrent, p. 69-86.
Par ailleurs, la bibliothèque municipale de Lyon propose une bibliographie sur les communs :
https://www.bm- lyon.fr/nos-blogs/democratie/decouvrir-444/article/bibliographie-les-communs
Le site internet de l’Appel du Rhône : https://www.appeldurhone.org
Source image : Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Wikipedia